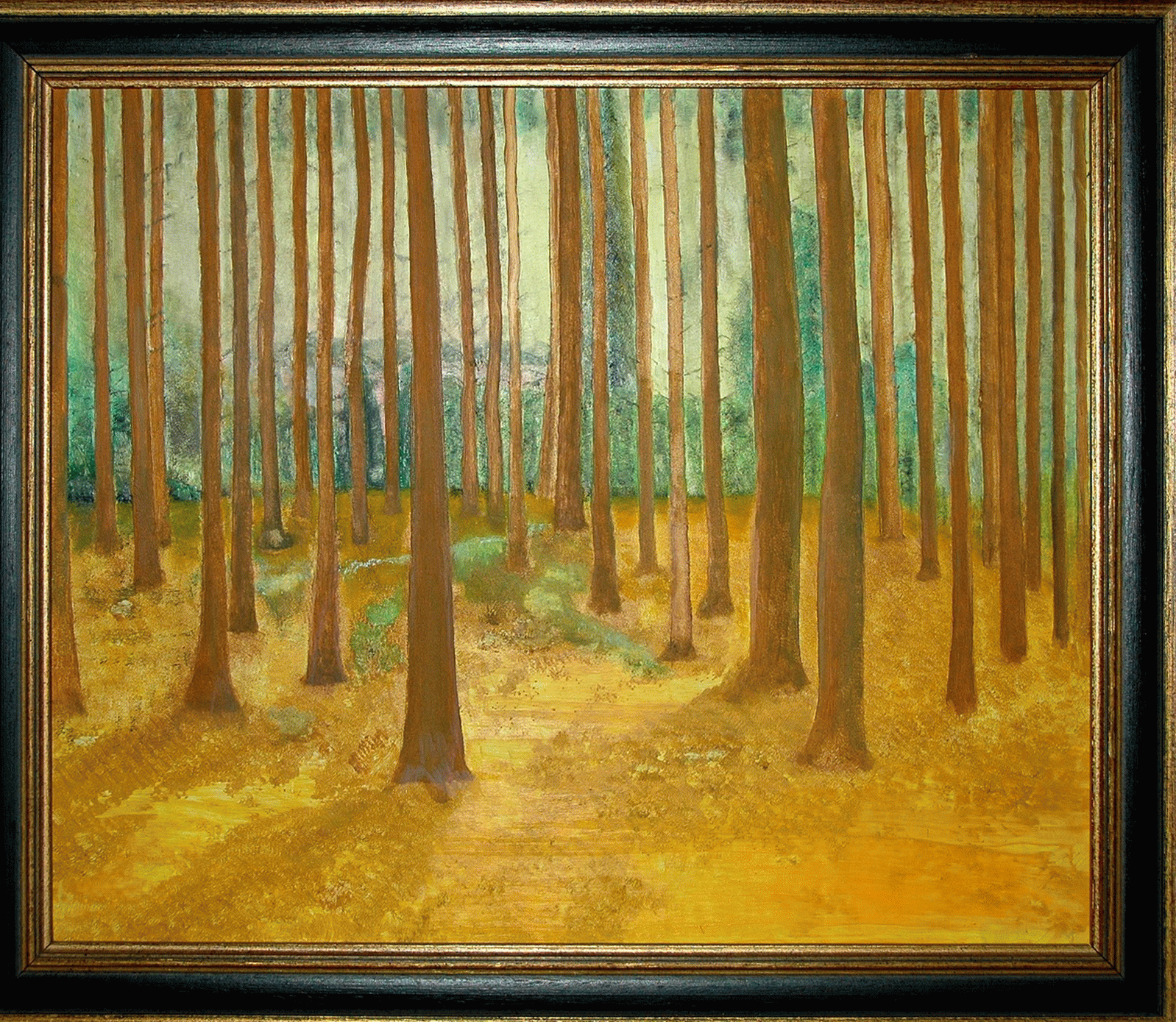La sapinière
(Vers 1995)
J’aime ce tableau. Je ne l’ai pas signé, parce que je ne suis pas sûr qu’il soit terminé. Ce fut souvent le cas. Il reproduit aussi ce que j’ai vu à un moment de ma vie. Non ce qu’il fut avant ni ce qu’il devint ensuite.
C’était une mode, dans les années soixante, de planter des conifères, appelés erronément sapins. Je cherchais aussi un moyen de ne pas tondre une propriété de quarante-deux ares. En un sens, je commis là une erreur. Qu’ils seraient grands et beaux les chênes, les hêtres rouges, les bouleaux, si je les avais plantés à cette époque. Impatients, nous voulions des arbres à pousse rapide qui seraient adultes de notre vivant. Déjà nous savions que le temps allait passer vite. Le bon peuple dont nous sommes n’a pas la visée d’une certaine noblesse qui plantait jadis pour les générations suivantes, pour un siècle ou deux.
Pour ce tableau, je me suis inspiré d’une création de Spilliaert, mais aussi de ce que je voyais derrière le manoir : un bois de six cents pins, plantés par une équipe, avec mon père et des collègues de l’institut Saint-Aubain, un bois sans charmille, sans le Bouddha, sans l’allée le long de chez Daix, sans le plan d’eau, un bois sans le lierre et le « sentier secret » dont parlait Victoria. Un bois tel qu’il est peint : tout de verticalité, des troncs vers un azur qu’on ne voit pas, des pins ébranchés, un écran de thuyas, une longue maison que l’on devine, et le jeu du soleil sur un sol jonché d’épines séchées, avec quelques ronces ou, tout au plus, un début de lierre.
Au début, les arbres étaient minuscules, plantés trop près l’un de l’autre, jusqu’à la terrasse. Ils ont poussé et ont constitué un terrain de jeu pour les enfants, les nôtres et ceux du quartier, le club des sourires du Clinchant, comme ils disaient. Emmanuel y a coupé des branches, tracé des tunnels, construit des camps. Ils ont joué parfois jusque tard les soirs d’été. Leur enfance terminée, nous avons abattu trois arbres sur quatre, septante-six devant la maison. J’ai ébranché les survivants. Quand il y a canicule, il fait bon se promener, jouir de la fraîcheur, déguster le parfum des épicéas. J’avais aussi gagné sur l’herbe, assisté par le lierre qui s’est planté tout seul. Cette partie du jardin allait évoluer.
Le jardin vit au rythme des ans, des besoins, des enfants, du temps dont on dispose pour l’entretenir, de l’argent disponible et des goûts. Ceux-ci évoluent au cours d’une vie humaine. Nous aurions gagné à payer un architecte de jardin, un paysagiste, mais ce n’aurait pas été notre jardin. Celui dont on est fier parce qu’il est sorti de nos mains et qui fait du bien aux visiteurs. Ils ont été nombreux à en profiter. Quelle ambiance, une fois à l’ombre des pins ! Que d’écureuils ! Que d’oiseaux : troglodytes, mésanges, geais de chêne, pouillots véloces, pies, pinsons, bouvreuils, rouges-gorges, ramiers, tourterelles turques, hiboux, merles et merlettes, grives, pics verts et pics épeiches qui volent en riant ! Plus les hérissons, les fouines, les renards et deux chevreuils de passage.
Ce que j’ai peint, c’est le silence, la lumière tamisée, la fraîcheur, le plaisir du chez soi.